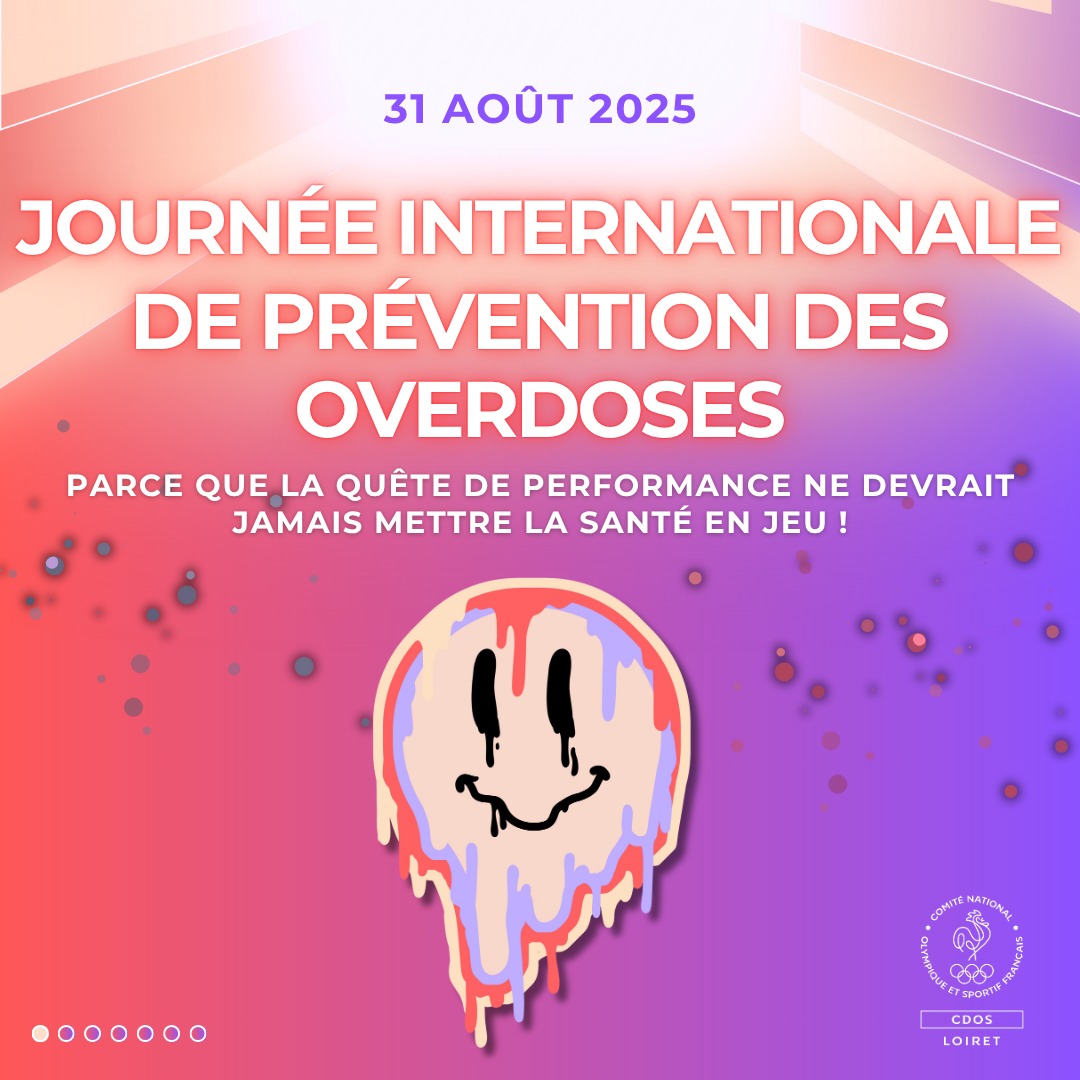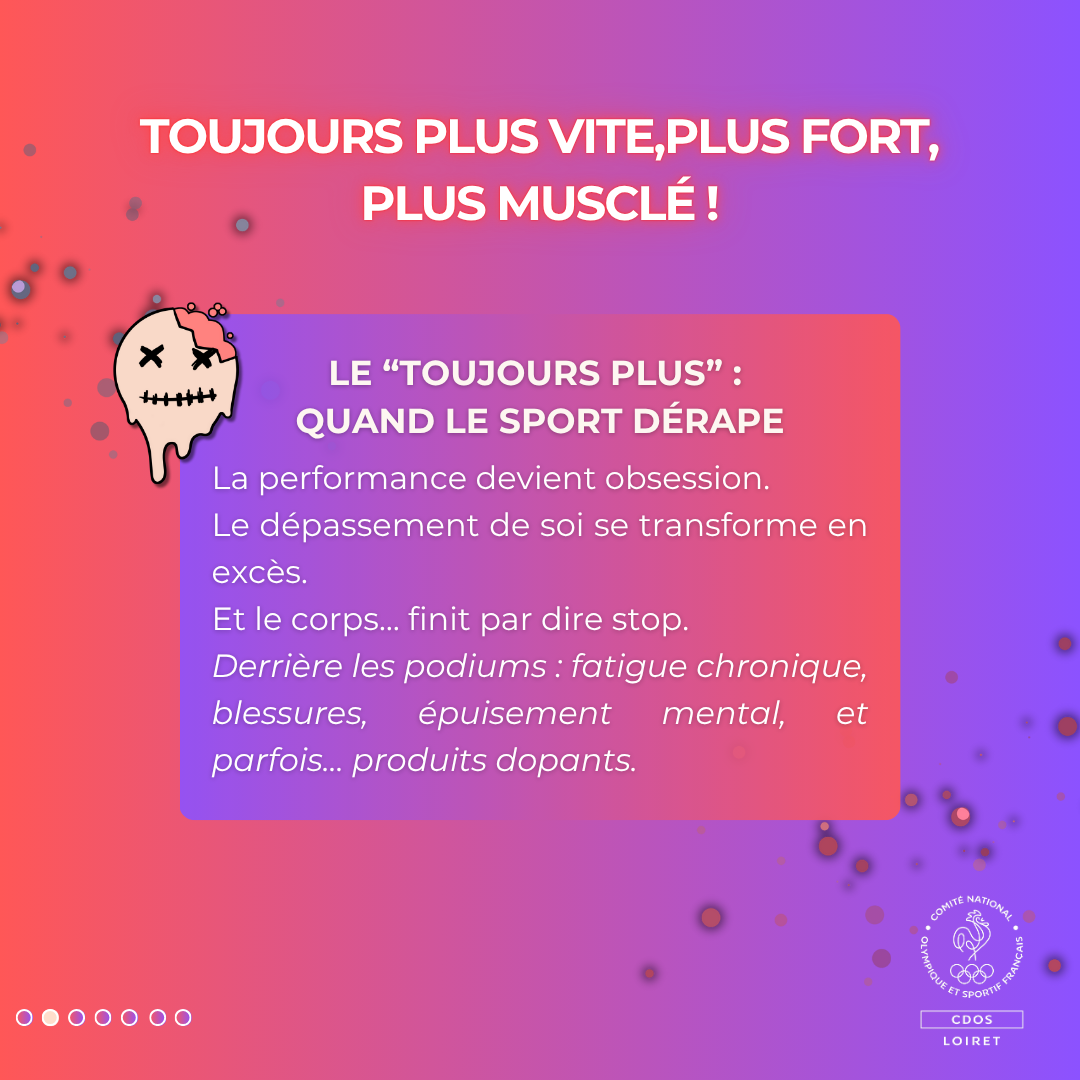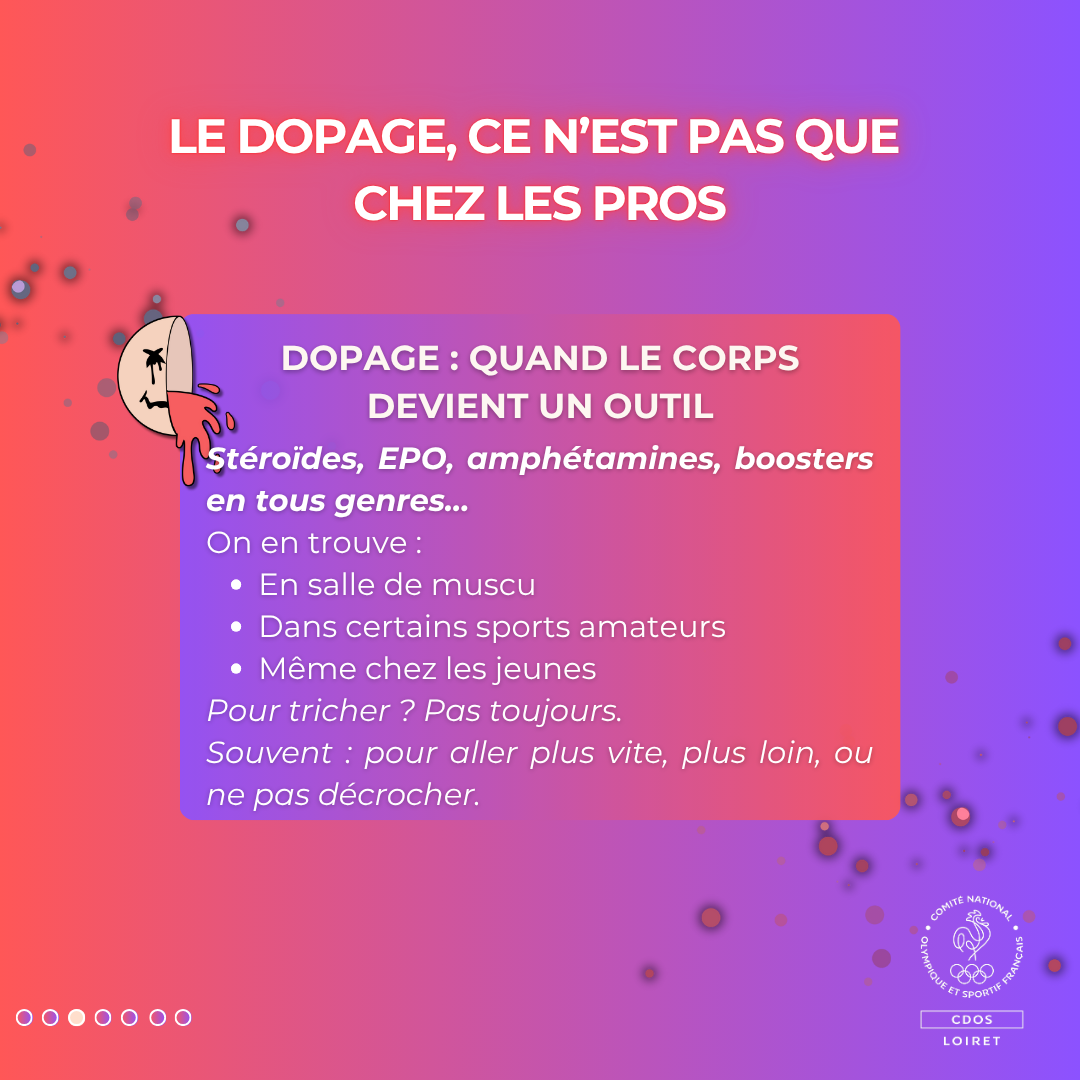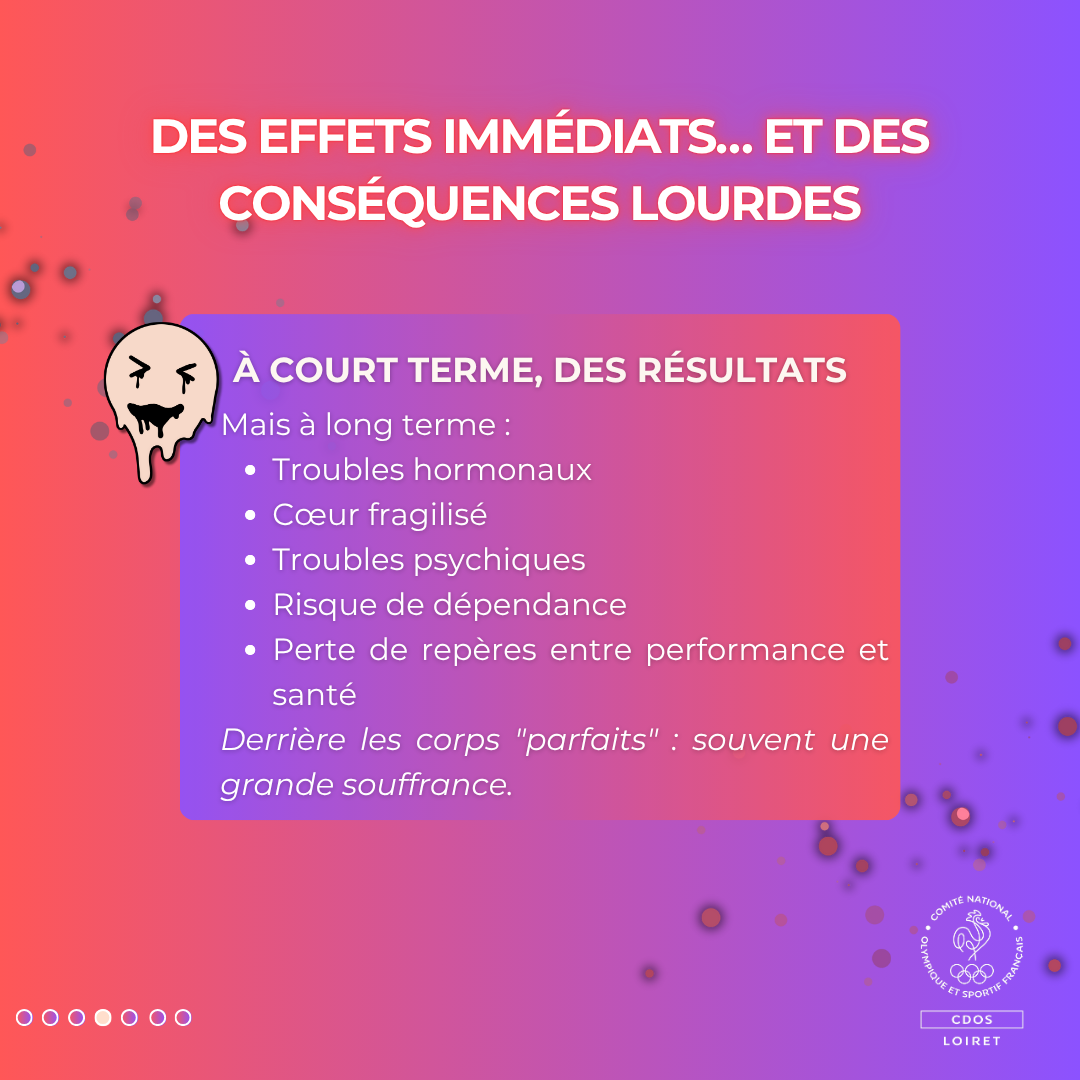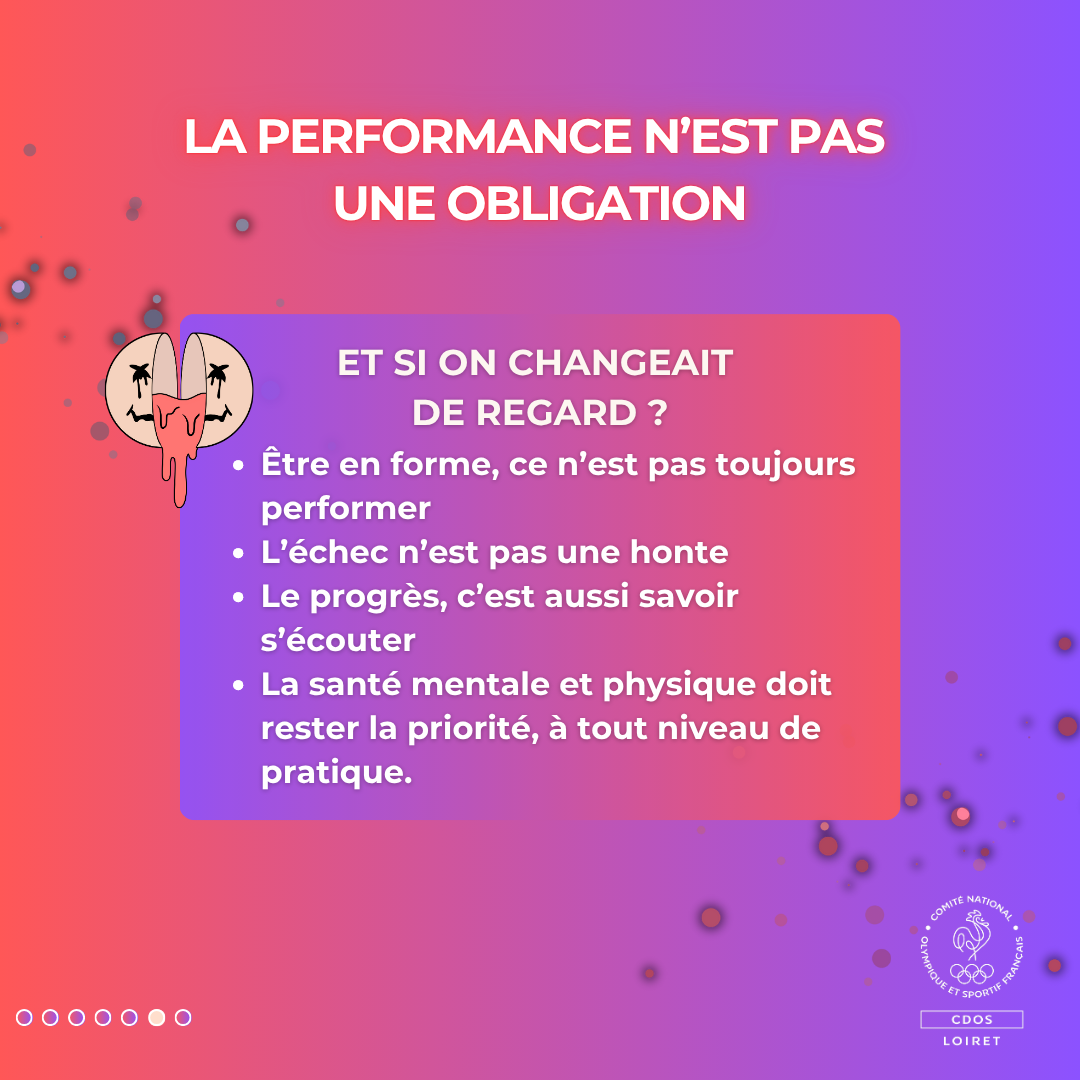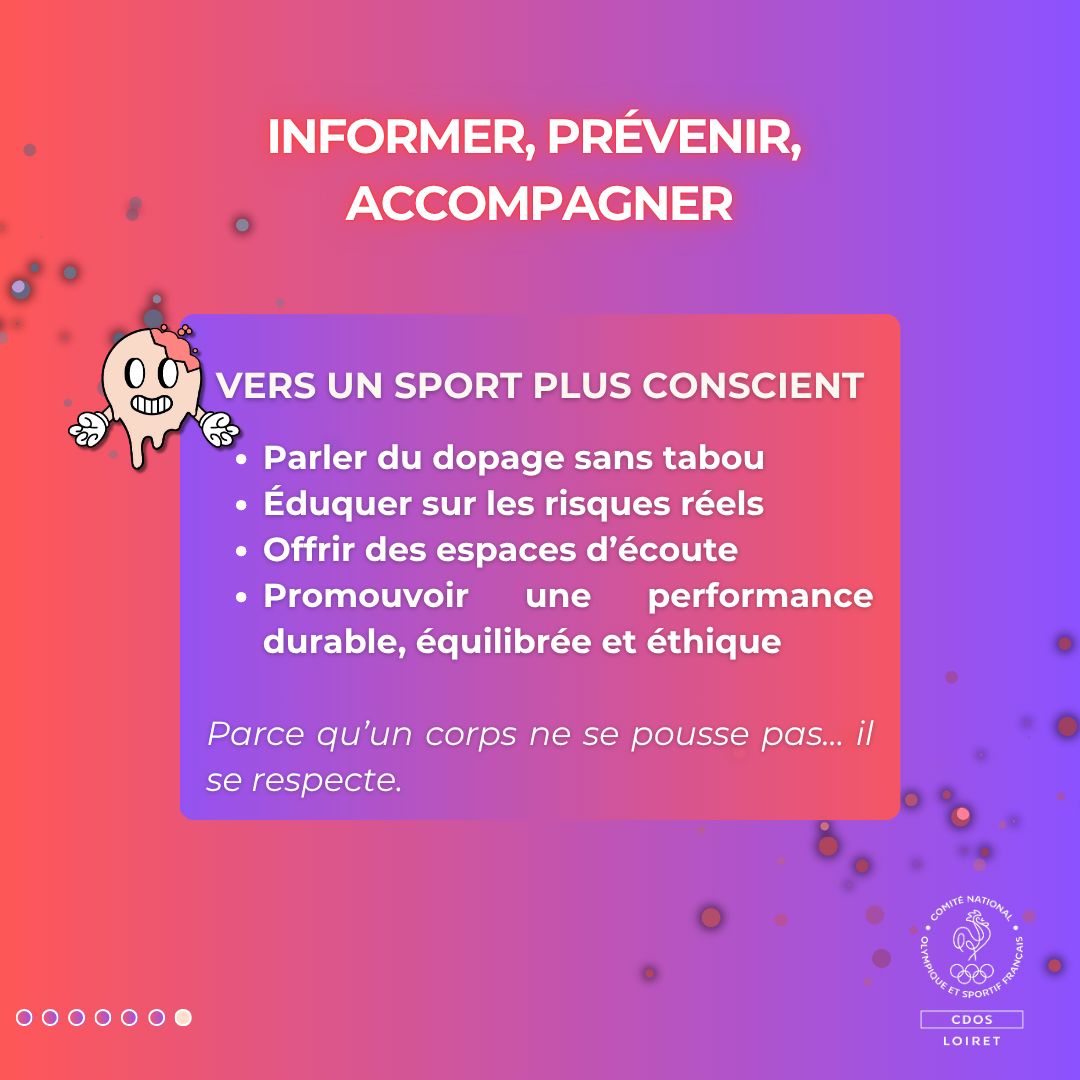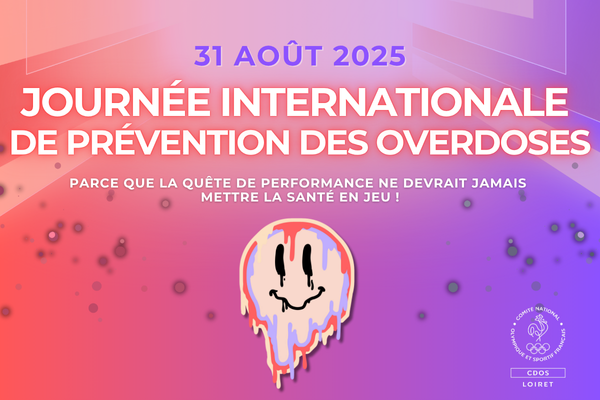Dans l’imaginaire collectif, le dopage reste souvent associé aux podiums, aux performances hors normes ou aux grands scandales du sport professionnel. Pourtant, il se faufile bien au-delà des stades olympiques. On le croise dans les salles de sport, sur les pistes amateurs, chez les adolescents, parfois même chez les débutants. C’est que le dopage n’est pas qu’un outil de triche. C’est, bien souvent, une réponse à une pression. Celle de devoir être plus fort, plus rapide, plus visible.
La journée internationale de prévention des overdoses nous invite à repenser cette logique. Car au fond, le dopage est rarement un choix neutre ou conscient. Il est la conséquence d’un système — sportif ou social — qui valorise la performance à tout prix, qui mesure la valeur d’un corps à sa puissance ou à sa silhouette. Et dans ce système, les dérives deviennent presque inévitables.
Chez de nombreux jeunes sportifs, le recours à des produits dopants ne répond pas seulement à un désir de victoire. Il traduit aussi la peur de ne pas être à la hauteur, la pression des classements, des likes, des regards. Le corps devient un outil de reconnaissance, une carte de visite. On oublie qu’il est aussi un être vivant, fragile, évolutif.
Le problème, c’est que le dopage n’est jamais sans conséquences. Et celles-ci vont bien au-delà des risques physiques déjà connus (atteintes cardiaques, hormonales, neurologiques). Il y a aussi l’impact psychologique : perte d’estime de soi, dépendance au résultat, isolement, voire dépression. Le corps dopé peut impressionner. Mais bien souvent, il souffre en silence.
Il est temps de réhabiliter un autre rapport au sport. Un sport qui valorise l’effort, oui, mais pas au prix de la santé. Un sport où l’on apprend à se connaître, à progresser à son rythme, à échouer aussi — car l’échec est un apprentissage, pas une honte. Un sport où la force mentale ne se mesure pas au nombre de séances, mais à la capacité à dire “non” quand il le faut.
Prévenir le dopage, ce n’est pas seulement interdire des substances. C’est surtout écouter, éduquer, valoriser autrement. C’est offrir des repères, des modèles, des espaces de parole. C’est encourager les clubs, les éducateurs, les fédérations à parler ouvertement de cette réalité, sans tabou, sans jugement.
En cette journée, rappelons que la santé ne doit jamais être une variable d’ajustement au service de la performance. Le sport doit rester un espace de construction, pas de destruction. La vraie réussite, ce n’est pas de dépasser tout le monde. C’est de tenir debout, entier, longtemps — et avec plaisir.